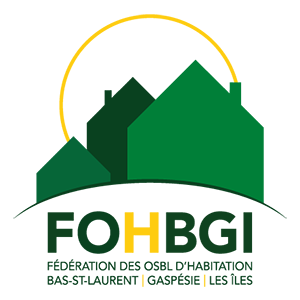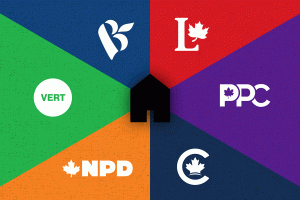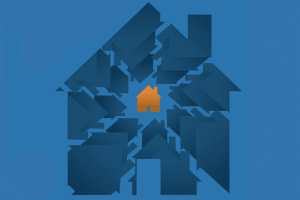En effet, la situation d’une famille ou d’un individu sans toit résulte plutôt d’un dysfonctionnement. Elle traduit une fracture sociale, une souffrance, une précarité, un manque de soutien et des traumas.
Le phénomène a plusieurs visages. Ceux-ci sont complexes et nuancés. De plus en plus de groupes sociaux sont représentés dans l’équation.
D’ailleurs, près du quart des personnes sondées lors du dénombrement de 2022 ont signalé que la cause de leur situation d’itinérance était une forme ou une autre d’éviction. Bien que depuis le 6 juin 2024, un moratoire de trois ans les protège contre certaines évictions, les locataires ne sont pas complètement à l’abri du phénomène. Les propriétaires véreux trouvent, pour leur part, d’habiles subterfuges pour assouvir leur soif de profit.
L’itinérance peut prendre plusieurs formes. Elle peut être situationnelle, cyclique, chronique, cachée ou institutionnelle. Il ne faut négliger aucune des situations dans le portrait global.
Les mécanismes de survie des femmes sont différents, et ceux-ci les rendent plus sujettes à vivre de l’itinérance cachée.