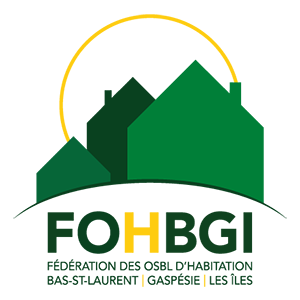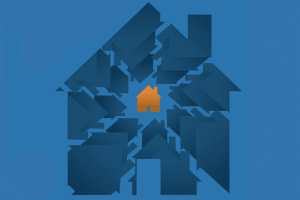Celle qui, dès 1979, a participé à l’ouverture de la première maison d’hébergement francophone pour les femmes victimes de violence a observé sous toutes ses coutures les liens entre causes sociales, débats politiques et actions concrètes pour le respect des droits les plus fondamentaux. Lucie Lamarche a souvent collaboré avec les groupes communautaires dont la Ligue des droits et libertés, elle a été une pionnière en matière de pratique féministe du droit et elle met depuis le début des années 1980 sa verve et son engagement au service des étudiantes et des étudiants de l’UQAM.
Quand on lui demande de nous donner sa définition du droit au logement, après une courte mise en garde (« Il n’y a jamais qu’une seule acception possible d’un droit donné, c’est un concept ouvert »), elle poursuit : « Le logement doit être premièrement accessible, deuxièmement abordable et troisièmement adéquat. » On pense à adéquat bien sûr en termes de surface, de proximité de services de qualité (hôpital, école, transports collectifs, etc.), mais aussi, ce qui est moins évident, en termes d’adéquation culturelle : « un logement à Iqaluit ce n’est pas un logement à Drummondville ». En effet, il ne s’agit pas seulement de construire des blocs, comme on l’a fait trop souvent : une maison, sa forme, sa disposition, les matériaux qui la composent, la division intérieure sont autant d’éléments qui traduisent des cadres culturels et des manières de voir particulières. Accessibilité, abordabilité, adéquation : « ce sont un peu les trois vertus sacramentelles du droit au logement ».
Quatrièmement, chacune des composantes du droit au logement doit être élaborée de manière non discriminatoire. Attention, lorsque l’on parle de discrimination, on ne parle pas uniquement de celle, bien connue, offensante et directe : « ‘‘Pas d’enfants, ici c’est juste des vieux’’ ou ces propriétaires qui ne louent pas à des personnes racisées. » On doit également aborder la discrimination sous l’angle des effets indirects que peut avoir une mesure donnée. « La discrimination indirecte, c’est celle qu’on vit beaucoup dans nos sociétés contemporaines, où une politique en apparence neutre produit des effets discriminatoires. » L’exemple de l’interdiction d’animaux domestiques pourrait être donné : une interdiction qui ne vise pas nécessairement à empêcher une personne non voyante d’occuper un logement, mais qui, en raison de son application uniforme, a un effet discriminatoire sur celle-ci. La discrimination systémique, qui est sur toutes les lèvres aujourd’hui, est cependant plus difficile à appréhender : « C’est lorsque personne n’est isolément responsable de la situation discriminatoire, nous dit la juriste, mais que le ‘‘système’’ produit la discrimination. En matière de logement, il ne s’agit pas des locateurs véreux, mais plutôt de l’appareillage des politiques publiques ». Sachant que les personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances ont d’immenses difficultés à se trouver un logement tout court (on ne parle même pas ici de convenable ou d’abordable), le peu d’empressement des gouvernements, ou leur négligence, dans la construction de logements sociaux accessibles pour ces personnes peut être assimilé à une forme de discrimination systémique. À cet égard, le marché de l’habitation, qui induit des distorsions et des inégalités portant préjudice aux personnes à faible revenu, ne saurait être situé ailleurs qu’au centre des politiques publiques visant à garantir le droit au logement…
« Le cinquième pilier du droit au logement est la participation. Je sais qu’on vit dans une ère de ‘‘surconsultation’’, qui sont parfois plus esthétiques qu’utiles ou performatives, mais la seule façon de trouver le point de rencontre entre l’égalité ou l’interdiction de la discrimination et les composantes du droit au logement est d’en parler. Pour prendre un exemple bien québécois, le droit au logement ce n’est pas de dire ‘‘la solution c’est les HLM donc c’est les HLM’’ ou ‘‘la solution c’est les OSBL donc ça va être des OSBL’’. Le mode de livraison peut être polyforme, dans la mesure où il respecte les balises dont nous avons parlé. » La participation de la population dans la recherche des solutions et la mise en œuvre des politiques publiques est donc une partie intégrante du droit au logement.
Le droit de tous les droits
Lucie Lamarche trouve utile cette affirmation qu’elle entend de plus en plus souvent : le droit au logement c’est le droit de tous les droits. « On est mal logé, on est malade, on est mal logé, on est sale, on est mal logé, on ne sait pas quoi faire pour servir sa nourriture, on est mal logé, nos enfants ne sont pas en sécurité. » Elle se méfie toujours de l’adjectif fondamental, « mais ce qui confère un ‘‘avantage’’ au droit au logement, c’est qu’on peut l’aborder, comme le disait la sénatrice Dupuis dans votre dernier bulletin (lire le texte « Le logement est-il un droit ? » dans le Réseau n°50), sous l’angle de la sécurité et de la sûreté. Parce que c’est le droit de tous les droits, on peut assez facilement imaginer des situations où l’absence de logement est génératrice de toutes sortes d’insécurités. Ne pas avoir de toit, c’est la quintessence de l’insécurité. Par contre, ça pose un problème lorsqu’on parle de politiques publiques. On est très branché ‘‘lutte à l’itinérance’’, ce qui est une bonne chose, mais ce n’est pas le ‘‘droit à l’abri’’ que l’on réclame, c’est le droit au logement. »
Ces dernières années, des jugements de cour ont établi que des personnes itinérantes avaient le droit d’ériger des structures rigides dans des parcs pour se protéger quand il fait froid. « Ce ne sont pas de mauvaises décisions, dit Lucie Lamarche, je suis très heureuse que les personnes itinérantes ne soient pas chassées des parcs ! Mais dans le droit au logement, il doit y avoir une pérennité, une sécurité, une stabilité, une qualité des matériaux, une qualité du tissu social auquel on appartient, une proximité de services, l’accès au travail, etc. Je me demande parfois si cela n’arrange pas les décideurs d’entretenir une petite confusion entre le droit à l’abri et la pérennité du droit au logement. J’ai toujours été intriguée de voir cette confusion, accidentelle ou pas… Le fédéral annonce une politique de lutte contre l’itinérance en même temps qu’il annonce une politique pour le logement : il ne faudrait pas qu’il y ait une confusion des enjeux. C’est sûr que l’abri c’est le minimum essentiel, urgent, mais ce n’est pas la même chose. Dans le droit au logement, il y a cette idée de temps long. C’est comme cela que l’on construit son estime de soi, sa sécurité, que l’on met ses enfants en sûreté. »
Comment garantir ce droit dans la législation ?
Actuellement, le droit au logement ne figure pas de manière explicite dans les chartes canadienne et québécoise des droits. Cela s’avère parfois frustrant. En 2014, une tentative de forcer la main du gouvernement de l’Ontario en matière de droit au logement a échoué. Mme Lamarche résume ainsi le cas : « L’affaire Tanudjaja contre Canada mettait aux prises des personnes mal logées d’Ottawa représentées par un groupe d’avocats qui voulait contraindre l’Ontario à prendre des mesures en faveur du logement. Quatre cas différents de familles, des gens mal logés. Par exemple, un père handicapé avec deux enfants, dont un handicapé, qui ont un logement si petit qu’ils ne peuvent pas circuler à deux dans leur appartement avec deux fauteuils roulants; un autre qui est à risque d’éviction, et une qui est vraiment itinérante. Le regroupement d’avocats s’adresse au tribunal en disant : ‘‘le gouvernement de l’Ontario a une obligation positive d’adopter et de mettre en œuvre un politique de logement’’. Sous-entendu : pas seulement quand cela lui conviendra, non, c’est un devoir de l’État. » La réaction du gouvernement de l’Ontario a été d’une simplicité désarmante : il n’a trouvé nulle part dans la Charte canadienne le droit au logement… et l’affaire a été classée sans suite.
« On est un peu tannés de s’en remettre à l’implicite dans les chartes. D’où l’argument de la sénatrice Dupuis : ‘‘Il y a des poignées qu’il faut utiliser dans les chartes telles qu’elles sont écrites actuellement.’’ C’est ce que j’appelle les chemins de traverse. On va passer par la discrimination, on va passer par la sûreté de la personne. Ça nous permet, lorsqu’on refuse une personne dans un logement pour des motifs discriminatoires, d’indemniser cette personne. Pas en lui donnant un logement, non, en l’indemnisant pour la discrimination qu’elle a subie. On peut faire ça mille fois, et Dieu merci il nous reste une Commission des droits pour le faire, on peut faire ça 3 000 fois, on n’a toujours pas de logement ! On a une indemnité. Une lettre d’excuses et un chèque de 2000 $ de dommages, mais on n’a pas de logement. C’est la limite des chemins de traverse : ce n’est pas transformateur. C’est réparateur, à la pièce, mais ce n’est pas transformateur. »
La frilosité des décideurs par rapport à l’enchâssement du droit au logement dans les chartes ou les instruments constitutionnels est basée sur une peur irrationnelle : ils se disent on ne va pas demander aux tribunaux d’écrire les politiques publiques ! C’est notre job de législateurs, ce n’est pas le mandat des tribunaux d’écrire les lois. « J’appelle ça la tempête dans le verre d’eau. Prenons un exemple qui ne nous est pas nécessairement sympathique, celui du bon docteur Chaoulli. » Le docteur Chaoulli a obtenu en 2005 de la Cour suprême un jugement favorable contestant la légitimité du système d’assurance maladie. « Dans le fond, la majorité de la Cour suprême a juste dit au Québec de refaire ses devoirs. Elle n’a pas dicté de conduite au gouvernement québécois comment rédiger sa loi ! Elle a simplement dit ‘‘refaites vos devoirs’’. On passe notre temps à dire ‘‘oh non il ne faut pas que les tribunaux touchent à ça parce que ce n’est pas correct que les tribunaux dictent les politiques’’. Mais ils ne font pas de politique ! Ils font simplement ramener le législateur à son obligation d’agir. »
Tout le monde convient qu’il n’est pas aisé de rouvrir la Charte canadienne des droits et libertés : « il y a une queue à la porte, et chacun a sa liste d’épicerie ! » Cependant il existe des solutions de rechange. La juriste cite la possibilité d’agir à la manière de la Loi canadienne de la santé, mais en matière de logement : des normes, des marqueurs, puis des mécanismes d’imputabilité. Ce serait parfait, même si c’était une loi ‘‘ordinaire’’ [par opposition à loi-cadre ou quasi-constitutionnelle]. La Loi canadienne de la santé, en dépit des négociations difficiles ces derniers mois, est une loi ordinaire qui fonctionne assez bien. » Ce genre de loi agit au niveau budgétaire et force la reddition de comptes : les investissements sont attachés à des balises à respecter. « Je privilégie cette option, contrairement à l’approche de Mme Dupuis qui est davantage une approche litige-plainte-discrimination, chose qui est absolument nécessaire, mais c’est du cas par cas. Nous avons désespérément besoin d’outils pour orienter l’action publique. On est un peu tannés d’expliquer aux juges c’est quoi être pauvre, on aimerait ça que le législateur comprenne quelles sont ses obligations. »