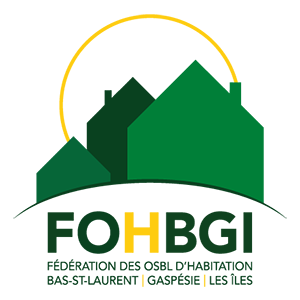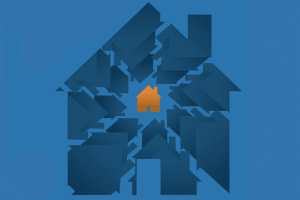3/ Mobiliser la solution incontournable du logement social et communautaire
Si l’itinérance augmente, la crise du logement persiste également. Plusieurs ateliers et conférences ont ainsi appelé à renforcer le parc de logements sociaux au Québec pour y faire face. Dans son atelier, le FRAPRU a communiqué l’objectif de 20% de logements sociaux et communautaires au Québec, pour résorber cette crise persistante du logement qui nourrit celle de l’itinérance. Le FRAPRU observait ainsi que « cette crise du logement change les visages de l’itinérance ».
Un autre atelier le soulignait : toujours d’après le dénombrement 2022 (tableau Raisons évoquées de la perte de logement), la première cause de perte de logement, évoquée par 23 % des répondant·es, est désormais l’expulsion par le propriétaire (la consommation de substances arrivant en seconde position). L’une des propositions de la Déclaration commune produite durant les États généraux, suggère ainsi de « reconnaître le caractère fondamental du droit au logement, développer massivement des logements sociaux et communautaires, y faciliter l’accès, contrôler le coût des loyers et assurer le soutien nécessaire au maintien en logement des personnes vulnérabilisées ».
4/ Protéger les plus vulnérables face à la crise sociale et à la crise climatique
Les visages de l’itinérance ont changé, rappelait-on au cours de l’évènement. Et les enjeux et difficultés auxquels les personnes itinérantes font face évoluent aussi, allant dans le sens d’une multiplication et d’une complexification.
En matière d’inégalités sociales, le Canada est un des pays les plus riches du monde. Pourtant toute une partie de la population vit dans des situations de pauvreté extrême. On observe aussi une part grandissante de travailleurs et travailleuses à revenus modestes. Dans tous les cas, la capacité à loger dignement les personnes n’est pas garantie actuellement au Québec.
À ceci s’ajoute un nombre croissant d’épisodes climatiques extrêmes à l’échelle mondiale. La récente vague de froid au Québec due à la déstabilisation du vortex polaire, les inondations liées aux pluies diluviennes, mais aussi les mégafeux qui font rage avec une occurrence accrue illustrent ce point. Dans les réponses à apporter à la crise de l’itinérance, il convient alors de considérer ces nouvelles réalités. En particulier, les fluctuations des températures observées durant les dernières années au Québec, et l’imprévisibilité climatique qui en résulte sont source de préoccupation. Les organismes doivent alors réorganiser leurs services pour faire face aux changements rapides de température. Pour ces raisons, le milieu communautaire demande de mettre en place des « haltes climatiques » (au lieu de strictes haltes chaleur), financées à la mission et ouvertes toute l’année.
> En conclusion
Il reste du chemin à parcourir pour renverser la tendance. Mais des intervenant·es, qui portent à bout de bras les solutions en réponse à la crise de l’itinérance, l’ont déjà partiellement tracé. C’est désormais aux décideurs et aux financeurs de prendre leurs responsabilités et de soutenir les organismes, pour que « vivre dans la dignité » soit réellement un droit pour chaque personne au Québec.