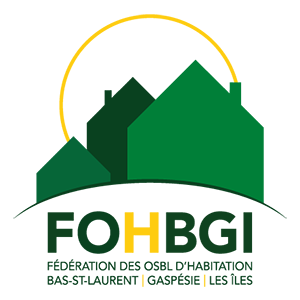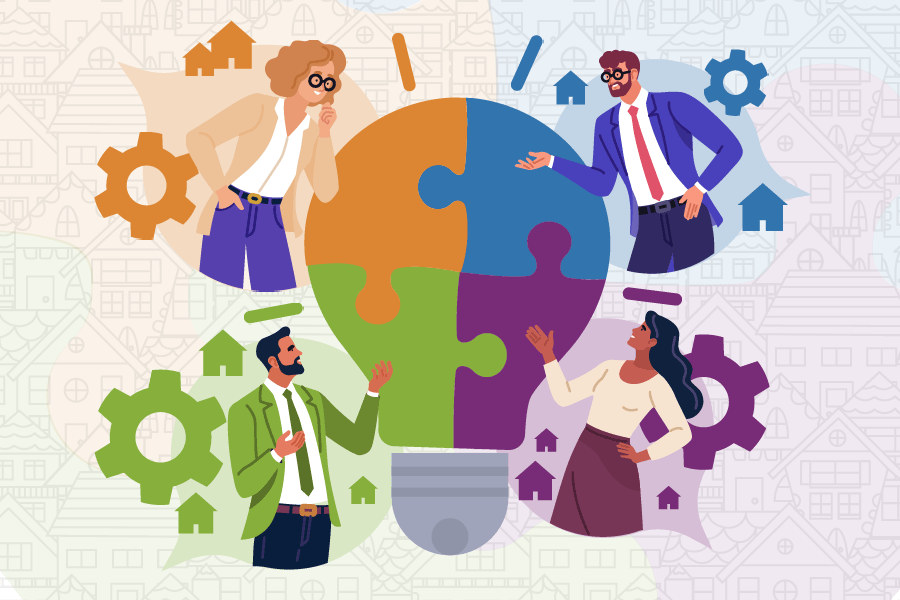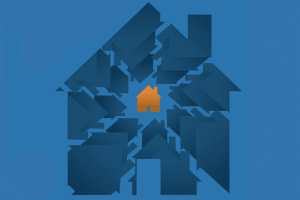> Qu’est-ce que la mutualisation ?
La mutualisation est le processus au cours duquel au moins deux entreprises d’économie sociale mettent en commun, répartissent ou partagent leurs ressources. Elle se veut collaborative, de sorte que l’union des forces de chaque groupe soit bénéfique de manière réciproque. Le spectre des éléments mutualisés est large : espaces, ressources humaines ou matérielles, expertises, services rendus, etc. On peut aussi parler de mutualisation de risques ou de clientèle. Bref, le champ des possibles est grand.
> Opportunités et contraintes
Ultimement, la mutualisation contribue au changement d’échelle. Ce changement d’échelle peut être souhaitable pour assurer la pérennité de l’organisme au niveau financier ou encore pour élargir ses activités et la portée de sa mission. Entre OSBL-H, nous pouvons par exemple envisager la mutualisation de ressources humaines.
Évidemment, la mutualisation entraîne un lot de contraintes et il importe de bien considérer les potentiels éléments perturbateurs avant de s’engager dans le processus. À titre d’exemple, il sera indispensable de réfléchir en amont sur la gouvernance lorsque les décideurs se multiplient. En ce sens, des efforts importants doivent être déployés pour définir les lignes directrices de la collaboration en respect des missions et des valeurs de chaque joueur.
Bien sûr, il est tout à fait envisageable de mutualiser certaines ressources permettant d’optimiser et de rationaliser les opérations d’OSBL-H sans mettre en péril l’indépendance et le rôle unique de chacun de ceux-ci. Il ne faut d’ailleurs pas confondre mutualisation et fusion d’organisme.
> Des ressources pour appuyer les réflexions
Somme toute, le processus de mutualisation requiert un changement organisationnel et dépendra de la volonté de l’organisme d’y procéder en fonction d’une évaluation exhaustive des opportunités et des contraintes, dont les coûts requis pour y parvenir ! Pour approfondir la réflexion sur la mutualisation et sa mise en œuvre, nous vous recommandons de consulter le Guide sur la mutualisation en 6 étapes pour un partage réussi du TIESS et le Le Petit Guide orange du partage des ressources et de la mutualisation du RCAAQ.