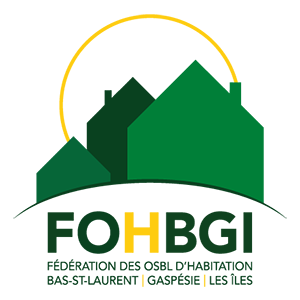Grâce au soutien financier du CISSS de Chaudière-Appalaches, la Fédération régionale des OBNL d’habitation de Québec et Chaudière-Appalaches (FROHQC), le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) et la Fédération des coopératives d’habitation de la région (FÉCHAQC) organisent actuellement une tournée conjointe auprès de leurs membres. Les acteurs de l’habitation communautaire se présentent dans chaque MRC pour présenter à leurs membres le Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social ainsi que les critères arrêtés au sein du comité régional de concertation. L’objectif de ces rencontres est d’aller à l’écoute des besoins des organismes et de prioriser les actions du prochain déploiement régional en soutien communautaire.
Des rencontres se sont déjà déroulées dans Montmagny, L’Islet, Bellechasse, Les Etchemins, la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche et se poursuivront jusqu’au 18 juin à Lévis. À l’issue de ces rencontres, un Forum régional sur le soutien communautaire aura lieu toute la journée du jeudi 24 octobre à La cache à Maxime, à Scott, au cours duquel le plan d’action régional sera présenté et discuté collectivement. Ce forum rassemblera, outre des représentant.e.s des OBNL, des coops et des OH, les partenaires majeurs des acteurs en habitation dans Chaudière-Appalaches, tels que Centraide, Emploi Québec, les commissions scolaires et des organismes communautaires régionaux.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la révision du cadre de référence initiée conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société d’habitation du Québec (SHQ). Elle vient aussi appuyer les démarches entreprises par les réseaux nationaux en habitation visant à accroître substantiellement le budget du soutien communautaire.